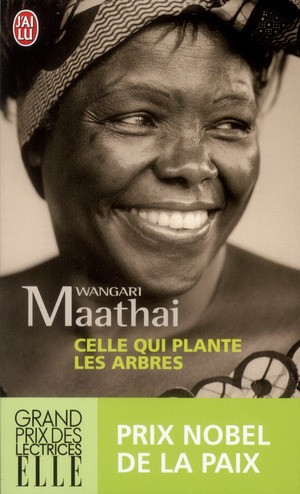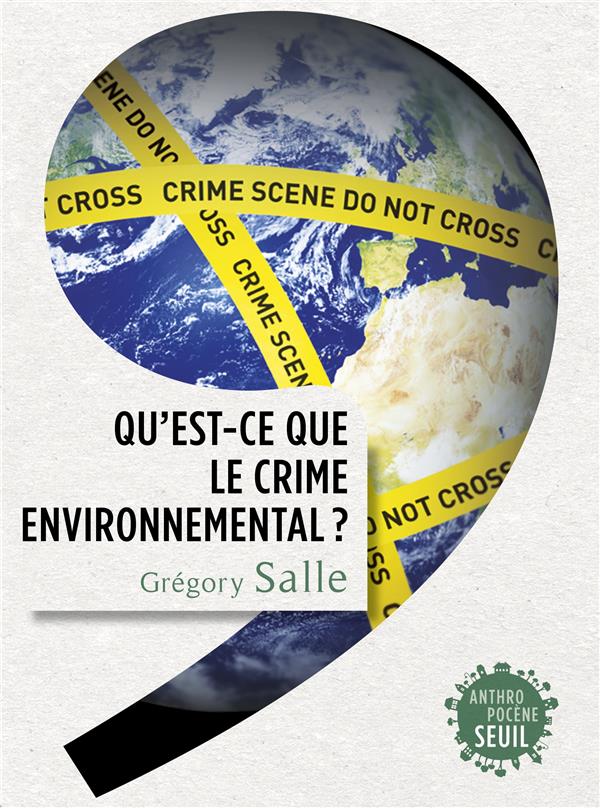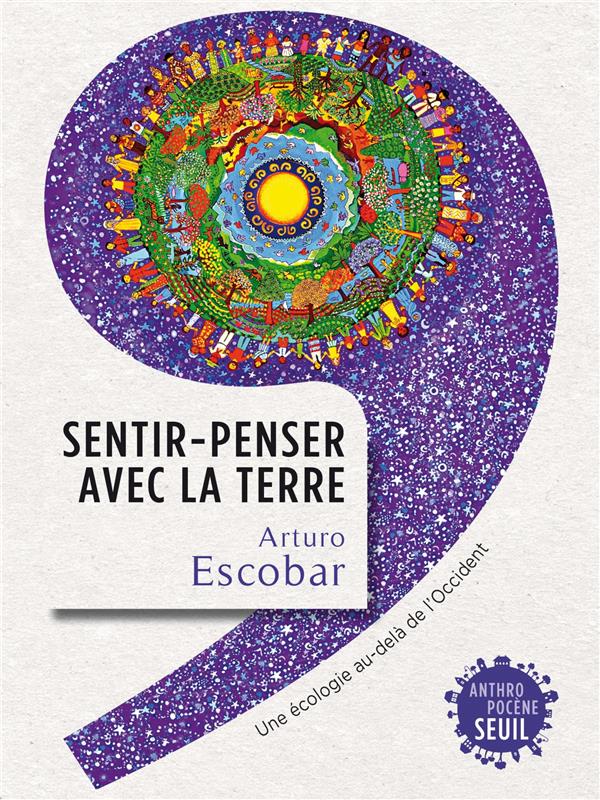Description
Les origines
Je suis née le 1er avril 1940 dans le petit village d’Ihithe, non loin de Nyeri, capitale de la province Centre du Kenya. Cette région des Hautes Terres, butant sur les contreforts des monts Aberdare et dominée, au nord, par le mont Kenya, avait également vu naître mes grands-parents et mes parents. C’étaient des paysans de la tribu des Kikuyu, l’une des quarante-deux ethnies du Kenya et, à l’époque comme aujourd’hui, la plus importante par le nombre. Ils cultivaient un petit lopin de terre et élevaient quelques vaches, chèvres et moutons.
Deux semaines après le début de mbura ya njahi, la saison des longues pluies, ma mère me mit au monde à la maison, dans une hutte traditionnelle aux murs de terre et de bouse séchée, sans eau courante ni électricité. Elle était entourée de quelques cousines, tantes et amies, et la sage-femme du village était venue l’aider. J’étais le troisième enfant et la première fille de la famille. Et j’appartenais à cette génération charnière qui eut le privilège de connaître les ultimes vestiges d’un monde ancien, dont la culture, les traditions, les croyances et jusqu’aux paysages commençaient inexorablement à disparaître.
Les campagnes des environs d’Ihithe étaient alors encore vertes, luxuriantes et fertiles. La région était tapissée de forêts, sous-bois et fourrés, foisonnants de fougères et de toutes sortes de plantes rampantes. Certains arbres, comme le mitundu, le mikeu et le mûgumo, donnaient des baies et des noix dont se régalaient les enfants. La terre, d’un beau rouge sombre, était riche et humide. Notre peuple cultivait de vastes champs de maïs, de haricots, de céréales et de légumes bien irrigués, et ne connaissait pas la faim. Le rythme des saisons était si régulier que l’on pouvait prédire sans trop de risque de se tromper que les grandes pluies de mousson commenceraient à la mi-mars. Ces pluies enflaient si bien les rivières que jamais on ne manquait d’eau potable. Et quand juillet arrivait, le brouillard à couper au couteau n’étonnait personne: on savait qu’à cette période de l’année, on ne verrait pas à trois mètres devant soi, et que les matins seraient si froids qu’une gelée blanche recouvrirait les pâturages. En langue kikuyu, juillet se dit d’ailleurs mworia nyoni, «le mois où les oiseaux pourrissent», car les oiseaux mouraient de froid et tombaient des branches!
Chaque naissance était célébrée par un très beau rituel, par lequel la communauté accueillait le nouveau-né sur la terre de ses ancêtres, aussi abondante que généreuse. À peine le bébé avait-il poussé ses premiers vagissements que les femmes qui avaient assisté à l’accouchement allaient couper sur l’arbre un gros régime de bananes encore vertes. Si un seul fruit était un peu trop mûr ou avait été picoré par les oiseaux, le régime était jugé indigne de cette grande occasion: il fallait alors en chercher un autre, généreux et entier, qui symboliserait la plénitude et le bien-être, deux valeurs essentielles aux yeux de la communauté. Puis elles faisaient la tournée des potagers et de leurs champs pour ramener aussi à la jeune mère des patates douces et de la canne à sucre – mais pas n’importe laquelle! Seule la kigwa kia nyamuiru, une variété indigène à tige mauve, faisait l’affaire.
La future mère avait pour sa part engraissé depuis plusieurs mois un agneau, qu’elle gardait jalousement à l’intérieur même de sa case. Pendant que les femmes collectaient les fruits et légumes traditionnels, le père de l’enfant sacrifiait l’agneau et en faisait cuire un morceau. On ajoutait alors les bananes et les patates douces sur le gril et, avec la viande et la canne à sucre, on apportait les plats à la jeune maman. Celle-ci mâchait consciencieusement une bouchée de chaque aliment pour bien le réduire, et donnait la becquée à son enfant. Tel fut donc mon premier repas; avant même d’avoir tété le lait maternel, j’avais goûté les fruits de notre terre: du jus de banane verte, de canne à sucre mauve, de patate douce et d’agneau gras.
Dès ma venue au monde, j’étais autant l’enfant de ma terre que celui de mon père, Muta Njugi, et de ma mère, Wanjiru Kibicho. Conformément à la tradition kikuyu, mes parents me donnèrent le prénom de ma grand-mère paternelle, Wangari.